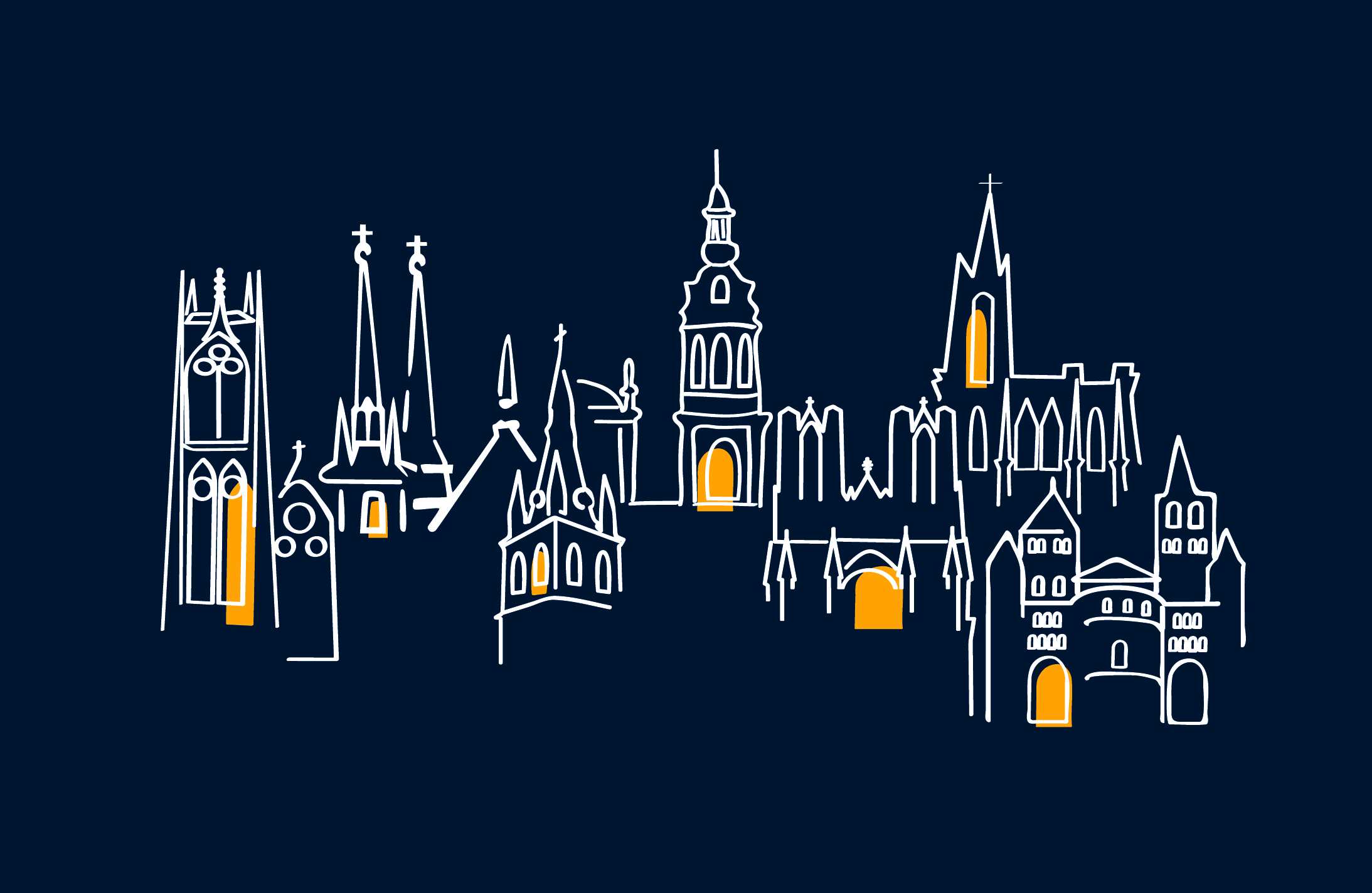Lectoure
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais
Antique cité des Lactorates, repliée ensuite sur son éperon qui domine la vallée du Gers, au temps des grandes invasions barbares, Lectoure atteste de la présence d’un évêque dès le VIe siècle. Sous le vocable de saint Gervais et de saint Protais, le sanctuaire actuel conserve son rang de cathédrale jusqu’à la suppression du diocèse de Lectoure, en 1801.
La cathédrale nous livre ainsi un vibrant témoignage de pierres et d’esprit des deux tiers de ce long millénaire d’existence de sa communauté chrétienne. Faite de destructions et de reconstructions successives, pour une cathédrale, toujours plus belle et majestueuse, l’histoire de ces hautes murailles, tête d’éperon, paraît vouée à une suite de résurrections, qui proclament le message du Christ Sauveur. Mais l’incendie de Notre-Dame de Paris nous rappelle, avec douleur, combien ces œuvres de foi sont, autant, des réalisations humaines, que nous avons le devoir de protéger, et, pour cela, de mieux connaître.
La conférence qui animera cette « Nuit des cathédrales » s’attachera à évoquer les deux dernières destructions majeures de la cathédrale de Lectoure : celle de 1473 et, surtout, celle de 1561, qui annonce les terribles guerres de Religion. Elle sera accompagnée d’intermèdes musicaux, et suivie d’une visite de son Trésor.
Sous une unité apparente, l’édifice actuel témoigne de cette histoire mouvementée. Une première (?) église romane, à coupole, est complétée, à la fin du XIIe siècle, sous la houlette de Mgr de Monlezun, avant d’être détruite, avec l’essentiel de la cité, en 1473, lorsque les armées de Louis XI mettent fin à la grande et turbulente maison des comtes d’Armagnac. La reconstruction du sanctuaire, en 1487, est l’œuvre du Tourangeau Mathieu Ragueneau, à qui nous devons la reconstruction de la nef et l’élévation d’un élégant clocher qui, avec son aiguille, culmine à 80 m au-dessus du sol. L’œuvre est poursuivie sou l’épiscopat de Mgr de Barton, avec le chœur, vers 1540. Les artisans découvrent à cette occasion, dans les soubassements, une vingtaine d’autels tauroboliques et crioboliques, qui furent consacrés à Cybèle et à Atys, après l’égorgement rituel d’un taureau ou d’un bélier, cultes venus d’Orient au cours des IIe et IIIe siècles après Jésus-Christ. Dès la Renaissance, Lectoure peut ainsi s’enorgueillir, en exposant ces pièces antiques, de posséder, l’un des premiers musées de France.
Mais la cathédrale est à nouveau détruite, hors son clocher, proie de l’iconoclasme huguenot, en 1561. La reconstruction du chœur et de la nef sont l’œuvre de la Réforme catholique du XVIIe siècle, timidement complétée au milieu du XVIIIe siècle. Peu avant la Révolution française, la flèche du clocher est abattue, le ramenant à 45 m de hauteur, et les reliefs ornementaux de la façade sont martelés.
De cette longue vie, de joies et d’épreuves, la cathédrale de Lectoure conserve une remarquable stature, majestueuse et équilibrée, qui recouvre, habilement, ses stigmates.
[/Serge Brunet/]
From Wikimedia Commons, the free media repository