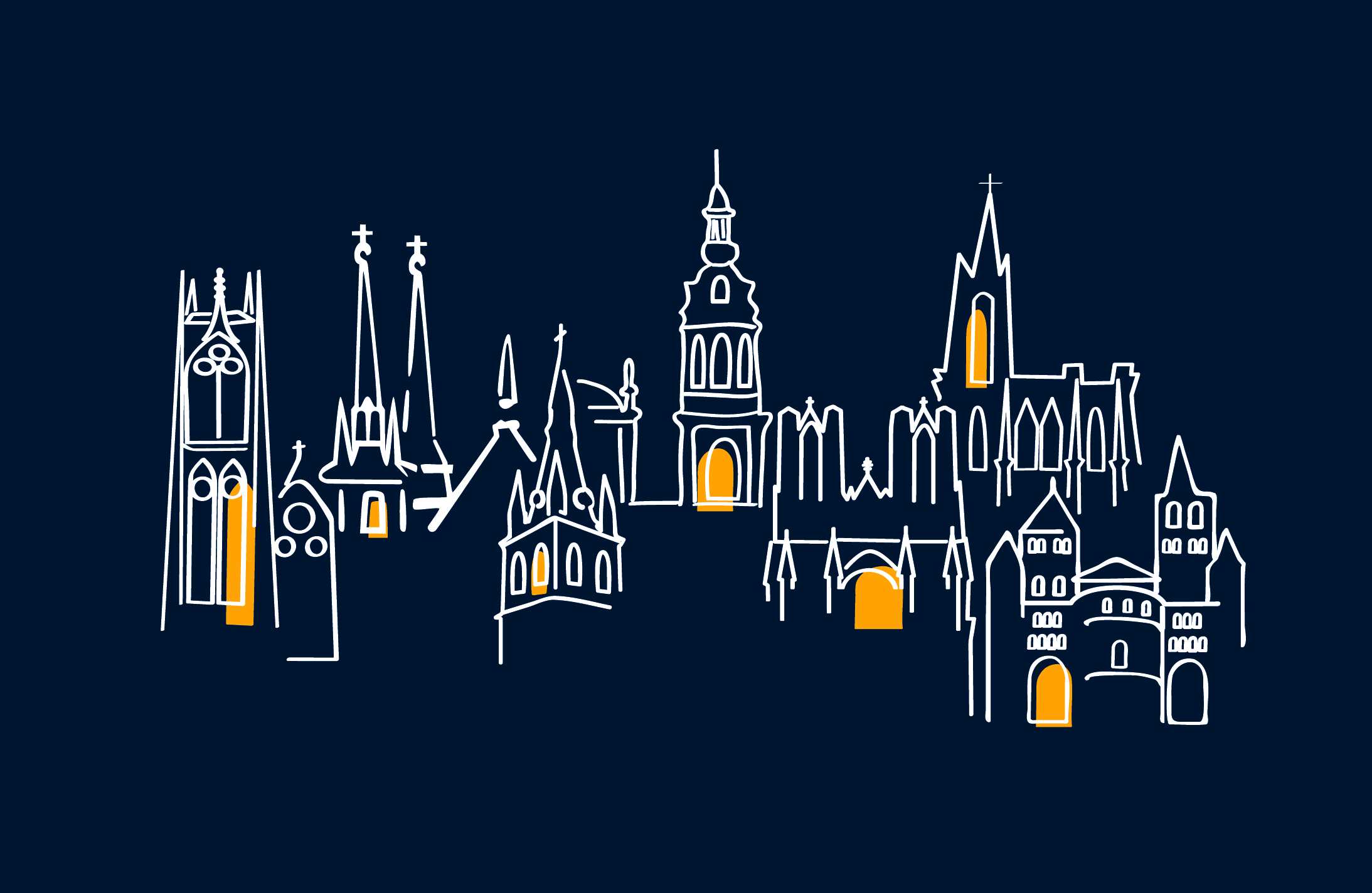Saint-Denis
Basilique de Saint-Denis
Le transept de l'église abbatiale, d'une ampleur exceptionnelle, fut destiné à accueillir les tombeaux royaux. Elle fut ainsi la nécropole des rois de France depuis les Robertiens et Capétiens directs, même si plusieurs rois mérovingiens puis carolingiens avaient choisi avant eux d'y reposer.
La basilique Saint-Denis, première église au monde construite dans le style dit gothique, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.
En 1966, la basilique fut promue cathédrale lors de la création du diocèse de Saint-Denis.
{{L'église du XIIe siècle}}
Dans la première moitié du XIIe siècle, entre 1135 environ et 1144, l'abbé Suger, conseiller des rois Louis VI et de Louis VII, agrandit l'abbatiale en remaniant le narthex d'une façade dotée pour la première fois d'une rose et de trois portails de grandes dimensions. Il modifia aussi le chœur en lui ajoutant des chapelles rayonnantes. L'abbaye bénédictine de Saint-Denis devint un établissement prestigieux et riche, grâce à l'action de Suger, abbé de 1122 à 1151. Ce dernier souhaita rénover la vieille église carolingienne afin de mettre en valeur les reliques de saint Denis dans un nouveau chœur : pour cela, il voulut une élévation importante et des baies qui laissent pénétrer la lumière.
Suger décida donc de la reconstruction de l'église en s'inspirant du nouveau style entraperçu dans la cathédrale Saint-Étienne de Sens. En 1140, il fit édifier un nouveau massif occidental, en s'inspirant des modèles normands de l'âge roman comme l'abbatiale Saint-Étienne de Caen. L'abbaye fut consacrée le 11 juin 1144, inaugurant le francigenum opus, appelé plus tard l'art gothique. Reprenant le principe du déambulatoire à chapelle rayonnante en le doublant, Suger innova en prenant le parti de juxtaposer les chapelles autrefois isolées en les séparant par un simple contrefort. Chacune des chapelles comporte de vastes baies jumelles munies de vitraux filtrant la lumière. Le voûtement adopte la technique de la croisée d'ogives qui permet de mieux répartir les forces vers les piliers.
C'est à partir du règne de Louis VI que rois de France se rendirent à l'abbaye pour lever l'Oriflamme de Saint-Denis avant de partir en guerre ou en croisade.
{{L'église du XIIIe siècle}}
Au XIIIe siècle, le besoin d’espace pour la nécropole royale imposa la reprise des travaux de reconstruction là où Suger les avait arrêtés. L’église présentait jusqu’ici une nef carolingienne, vétuste, coincée entre l’avant-corps et le chevet de Suger. Elle n’avait donc été reconstruite au XIIe siècle qu’à ses deux extrémités. On entreprit donc la reconstruction de la nef et d’un vaste transept, ainsi que le rehaussement du chœur de Suger et la reconstruction des deux tours de la façade, dont la flèche Nord qui culminait à 86 mètres de hauteur (elle sera détruite en 1846). De l’église du XIIe siècle, on ne conserva donc que la façade et la partie basse du chevet.
Après l’achèvement du grand transept dans les années 1260, le nouveau programme des monuments funéraires royaux visait à faire apparaître la continuité des trois races royales franques. Les monuments de Philippe Auguste et de Louis VIII situés au centre de l'édifice témoignaient donc de l'union en leur personne des lignages mérovingien et carolingien d'une part (dont les rois avaient leurs tombeaux au sud) et capétien d'autre part (dont les rois avaient leurs tombeaux au nord).
Le transept aux tombeaux royaux faisait ainsi le lien entre le haut chœur où se trouvaient les reliques à l’est, et le chœur des moines à l’ouest où retentissaient quotidiennement les prières au saint patron de la monarchie.
{{La restauration de la basilique au XIXe siècle}}
Après Jacques Cellerier (1813 - 1819) et François Debret (1813 - 1846), Eugène Viollet-le-Duc (1846 - 1879), reprit en main l'édifice et le sauve sans doute de la ruine, en achevant la restauration et en gommant une partie des interventions de Debret, jugées fantaisistes. Ce fut lui qui réorganisa les tombes royales telles qu'elles se trouvent encore actuellement.
Outre les nombreuses œuvres d'art liées à la nécropole, la basilique abrite également le premier orgue construit par Aristide Cavaillé-Coll. Cet instrument, conçu en 1840 par ce facteur d'orgues alors âgé de vingt-trois ans, comportait un nombre considérable d'innovations qui en faisaient un prototype unique au monde, ouvrant l'ère de l'orgue romantique (bien qu'il s'inscrive encore largement dans la tradition de l'orgue classique français). Doté de soixante-neuf jeux répartis en trois claviers et pédalier (mais sur quatre plans sonores manuels), il a été conservé presque intégralement dans son état d'origine, et est sans doute l'un des plus beaux instruments de France.
(Extraits de [->http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis])
From Wikimedia Commons, the free media repository