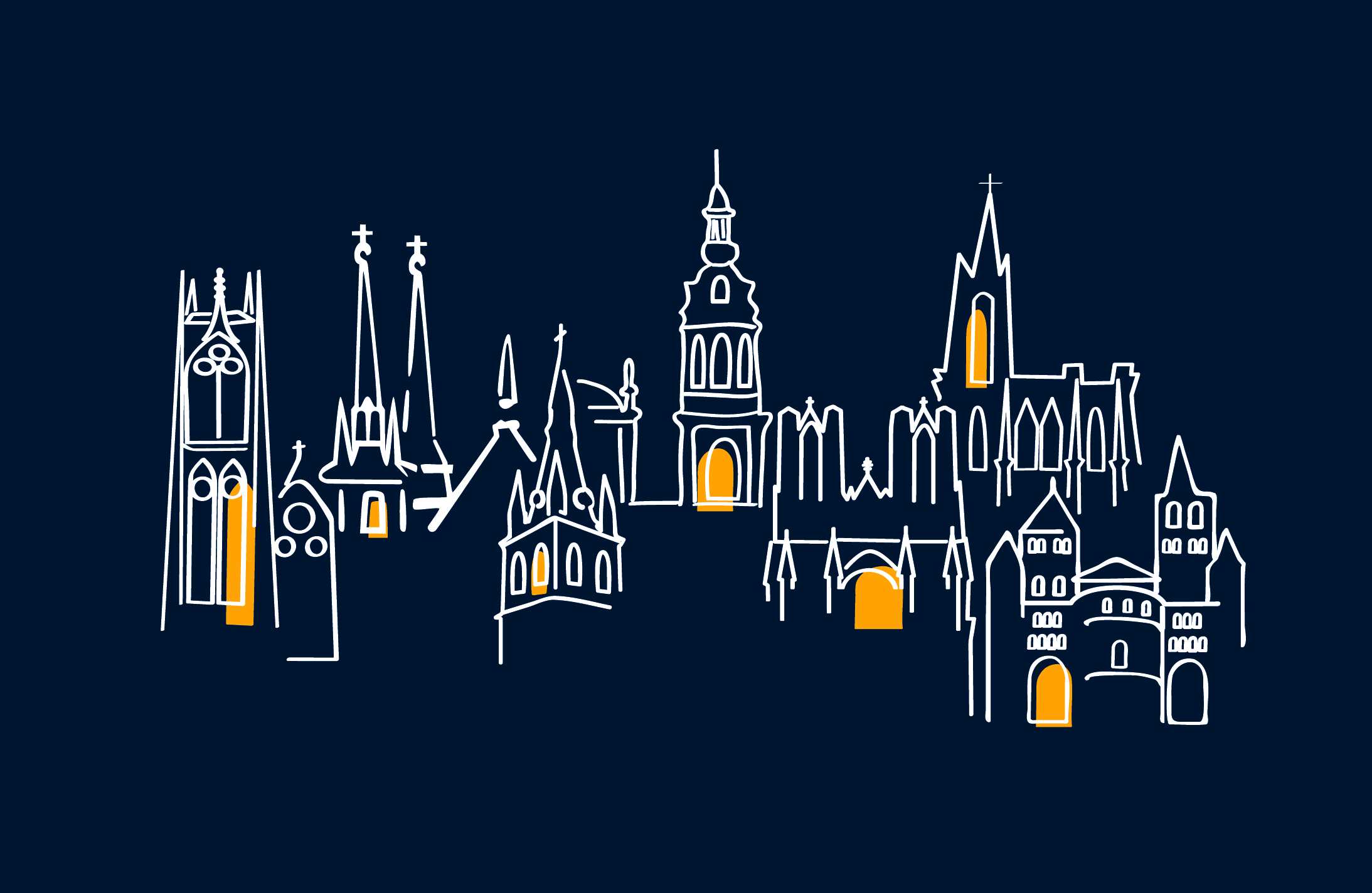Strasbourg
Cathédrale Notre Dame
La Cathédrale de Strasbourg est un des plus beaux joyaux de l’Art gothique et l’une des plus belles réalisations de l’architecture religieuse du monde occidental. Constamment au cœur de l’Histoire d’une Alsace déchirée par les guerres, elle est devenue l’emblème par excellence d’une Europe réconciliée. Le jaillissement de sa Flèche de 142m est le symbole de toute Libération humaine.
Siège de l’Archevêque et centre du Diocèse d’Alsace, le culte catholique y est célébré chaque jour. En son immense espace se déroulent toutes les grandes célébrations de l’Église diocésaine, ainsi que toutes les manifestations marquant les événements importants de l’Histoire régionale et européenne.
« Et surtout, souviens-toi qu’à Strasbourg
nous avons honneur et louange aux yeux de tous, sur cette terre.
À tous, en effet, elle plaît, notre Cathédrale
qu’à la louange de ton saint Nom nous avons dédiée ensemble
avec tant de grâce, telle qu’elle n’a pas d’égale dans toute la chrétienté.
Quiconque vient à Strasbourg et regarde la gracieuse Cathédrale, dit :
Ce sont pieuses gens qui ont fait cela,
qui ont consacré tant d’argent et tant de travail à ta louange.
Ton château, ta maison et ton palais que tu as,
grâce à notre travail et où tous les jours nous célébrons ton culte
en nous agenouillant devant toi avec ferveur.
On chercherait en vain bien loin, en tout pays,
une église aussi belle qu’ils t’ont bâtie.
En vérité, c’est la couronne qui domine tout,
au centre de la ville. »
Thomas MURNER, 1514
Historique de la Cathédrale
Strasbourg a été fondée par les romains en 12 avant JC ; les premières communautés chrétiennes doivent naître dans la région dès le IIe siècle, et au IVe siècle, la présence d’un évêque est attestée, saint Amand. Divers lieux de culte sont répertoriés sur Strasbourg, ils seront victimes des guerres et des incendies. En 1015, l’évêque Werner de Habsbourg lance la construction d’une basilique ottonienne, dont subsistent les fondations. A partir du début du XIIIe siècle, on reconstruit la cathédrale dans le style roman. La crypte, le transept Nord et le choeur datent de cette période. A partir de 1240, la découverte du style gothique va engendrer la reconstruction de la nef dans ce nouveau style.
En 1277 commence l'élévation de la façade ouest. La rose de la façade est établie en 1316. Les deux tours carrées à la française sont achevées en 1365. Les travaux d’adjonction d’un beffroi entre les deux tours et la réalisation d’une flèche unique terminent l’édifice en 1349. Avec ses 142 mètres de haut, la cathédrale sera jusqu’au milieu du XIXème siècle la plus haute construction de la chrétienté.
La ville de Strasbourg et sa cathédrale passent à la Réforme protestante en 1529. Le rétablissement du culte catholique sera décidé 150 ans plus tard par Louis XIV lors du rattachement de Strasbourg à la France (1681). Après la parenthèse du « {Temple de la Raison} » révolutionnaire, la cathédrale connaîtra de grandes restaurations tout au long du XIXe siècle. L’affaissement du pilier supportant la flèche marquera le début du XXe siècle. Les dommages de la 2eme guerre mondiale restent limités. En 2004, le réaménagement du choeur apporte une touche contemporaine.
Les vitraux
La cathédrale possède un ensemble exceptionnel de vitraux. Les plus anciens vitraux remontent au début du XIIIe siècle : le « jugement de Salomon » dans le transept Nord en est un exemple célèbre.
Dans le bas-côté Nord, les représentations des empereurs du Saint-Empire sont à rattacher au XIIIe siècle. De l’autre côté, dans le bas-côté Sud, les fenêtres racontent la vie de Jésus et de la Vierge Marie (1332 – 1350). Les vitraux de la chapelle Saint-Laurent proviennent de l’ancienne église des dominicains bombardée en 1870. Le vitrail dans l’abside du chœur est contemporain : il a été offert en 1956 par le Conseil de l’Europe.
La chaire
La chaire est l’œuvre de Hans Hammer, elle fut exécutée en 1485 pour le prédicateur Geiler de Kaysersberg. Elle se compose de plusieurs parties. La partie supérieure représente le Christ en croix, entouré de la Vierge, de St Jean, des apôtres et d’anges portant les instruments de la Passion. Le pilier central et la partie inférieure regroupe de nombreux saints et les symboles des quatre évangélistes ainsi que l’Agneau pascal. Les piliers extérieurs sont décorés de statues du XVIIIe siècle représentant de haut en bas : les Évangélistes, les Pères de l’Eglise ainsi que des personnages de l’ancien testament. A l’entrée de la chaire se trouve un petit chien rappelant la fidélité que l’on doit à la parole de Dieu.
L’orgue
Le pendentif qui date de la fin du XIVe siècle est flanqué de deux statues : le « Rohraffe » (singe hurleur) et un héraut avec sa trompette. Au centre prend place une représentation de Samson luttant contre le lion. Ces statues sont en fait des automates articulés. L’instrument fut reconstruit au début du XVIIIe siècle par André Silbermann qui ajouta les joues dorées au grand orgue. En 1981, le facteur d’orgue strasbourgeois Alfred Kern le restaura ; on peut entendre ses tonalités aux offices du dimanche et en concerts.
Le Pilier des anges
Le Pilier des anges est l’un des premiers éléments de la cathédrale gothique influencée directement par les maîtres de Chartres. Egalement dénommé « pilier du jugement dernier », il représente en bas les quatre évangélistes, au niveau intermédiaire des anges sonnant les trompettes, et en haut le Christ trônant, entouré d’anges portant les instruments de la passion.
L’horloge
L’horloge actuelle se réfère à deux époques : le meuble est toujours celui de l’horloge du XVIe siècle, le mécanisme quant à lui à été complètement refait par Jean-Baptiste Schwilgué entre 1838 et 1848. L’horloge doit sa célébrité tant aux nombreuses fonctions astronomiques et sa précision qu’au folklore de ses automates. L’horloge détermine les fêtes mobiles de l’année à venir et indique sur le calendrier le temps solaire, le mouvement de la lune ; c’est Apollon qui de sa flèche marque le jour. Au dessus défilent des chars : ils représentent les jours de la semaine symbolisés par les dieux antiques correspondants. Un cadran représentant le système solaire indique la position des astres. Dans la première galerie les quatre âges de la vie défilent devant le squelette de la mort : l’enfant, l’adolescent, l’adulte et le vieillard. C’est la mort qui sonne les heures. Au dernier étage, à midi, les douze Apôtres passent devant le Christ qui les bénit. Au même moment, le coq chante trois fois, nous rappelant le reniement de St Pierre.