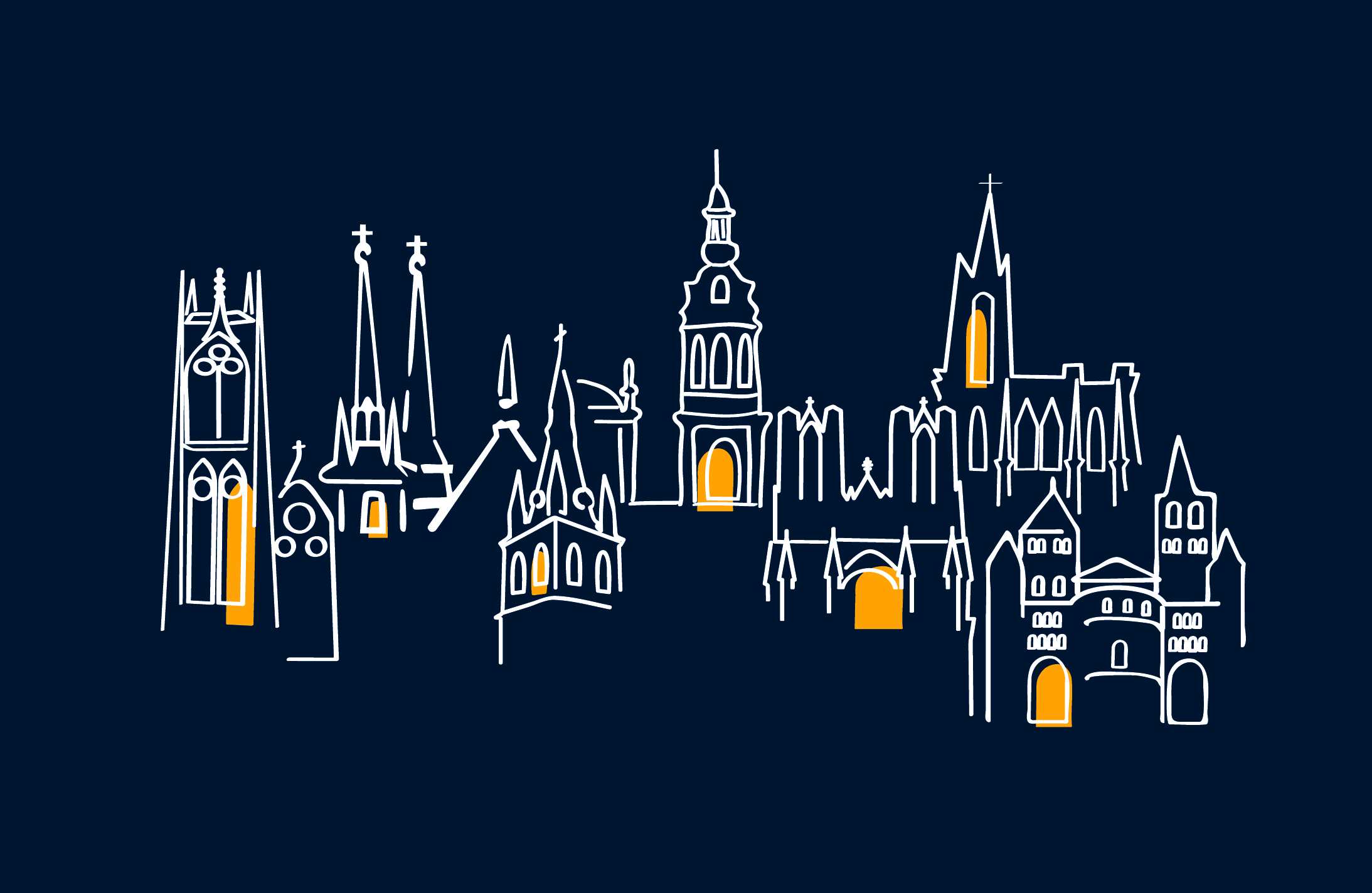Verdun
Cathédrale Notre-Dame
Probablement installée aux alentours de la cathédrale actuelle, à l’intérieur du castrum gallo-romain, il ne reste rien de la première cathédrale construite vers le milieu du IVe siècle, au moment de l’évangélisation de la ville par le premier évêque de Verdun, saint Saintin. Plusieurs fois détruite au cours du Haut Moyen ge, par les incendies et par les guerres, la cathédrale s’agrandit progressivement et l’on sait qu’elle comptait déjà deux chœurs et deux absides au milieu du VIIIe siècle lorsque l’évêque Madalvée rapporta des reliques de Terre Sainte pour son église.
La cathédrale actuelle, au plan double – avec deux transepts, deux chœurs et deux cryptes –, date de l’épiscopat d’Haimon et plus précisément des années 990, époque à laquelle on peut rattacher une grande partie du gros-œuvre (murs des transepts, piliers de la nef, etc.). En partie détruite par un incendie en 1047, la cathédrale d’Haimon fut restaurée sous l’épiscopat de Thierry le Grand (1046-1089) qui en profita pour l’embellir, ornant les hauts murs de la nef de motifs losangés en damier et modifiant notamment quelques portes, dont celle de l’Officialité – au pied de la tour nord-ouest – qui fut redécouverte intacte après la Première Guerre mondiale.
De nouveau endommagée au début du XIIe siècle, en raison d’un conflit qui opposa l’évêque de Verdun au voué de la ville, Renaud de Bar, elle fut en partie reconstruite sous l’épiscopat d’Albéron de Chiny (1131-1158) qui fit appel à l’architecte Garin. C’est de cette époque que datent l’abside orientale, le grand chœur et ses tribunes, mais aussi les grandes cryptes dont la partie supérieure a été restaurée après la Grande Guerre.
Si le style français (ou « gothique ») fit son apparition au milieu du XIIIe siècle, avec la construction du sacraire – qui servit pendant longtemps de salle capitulaire aux chanoines –, il ne s’y développa qu’à la fin de ce siècle, avec le voûtement sur croisées d’ogives des transepts et des collatéraux. La nef (qui était encore surmontée d’un plafond plat et lambrissé) et le grand-chœur ne furent voûtés qu’à la fin du siècle suivant, au moment où apparaissaient les premières chapelles latérales, qui allaient border l’édifice depuis sa façade méridionale jusqu’à sa façade septentrionale, la dernière chapelle latérale ayant été construite par les frères Musson, chanoines de la cathédrale, en 1525, juste à côté du grand portail nord.
Ravagée par un incendie en avril 1755, la cathédrale fut profondément modifiée par le chanoine de Plaine – avec le soutien moral et financier de Mgr de Nicolaï (1754-1769) –, son objectif ayant été de « moderniser » l’édifice, c’est-à-dire, en grande partie, de le priver de son aspect médiéval, trop barbare à son goût. La plupart des tombes furent alors supprimées, deux tours sur les quatre détruites et les deux autres arasées, le chœur abaissé au niveau du sol de la nef, les cryptes défoncées et comblées, la plupart des murs et des autels recouverts de boiseries ou de marbre, tandis que les portails romans furent obturés par une épaisse maçonnerie. C’est de cette époque également que date le baldaquin de la cathédrale, réplique assez fidèle de celui du Bernin de Rome, que le chanoine de Plaine installa lui-même en 1760.
La cathédrale, qui subit d’importants dommages durant la Première Guerre mondiale – en 1916, mais surtout en 1917 –, notamment au niveau de sa toiture et de ses voûtes, ne fut pas complètement anéantie, le gros-œuvre et la plupart des murs ayant été préservés malgré la violence des combats et des bombardements. Elle profita d’ailleurs d’une importante restauration, entamée en 1919 et qui s’étala jusqu’en 1934, certaines de ses parties romanes ayant alors été remises au jour et restaurées. C’est le cas du portail de l’Officialité (milieu du XIe siècle), situé au pied de la tour nord-ouest, et du portail du Lion (milieu du XIIe siècle), situé au nord-est de l’édifice, ainsi que des grandes cryptes orientales dont les piliers, reconstruits après-guerre, sont ornés de chapiteaux sculptés par Gaston Le Bourgeois, mettant en valeur l’histoire pluriséculaire de la cathédrale, mais aussi le passé douloureux de la Grande Guerre à travers la représentation de soldats et d’armements.
From Wikimedia Commons, the free media repository